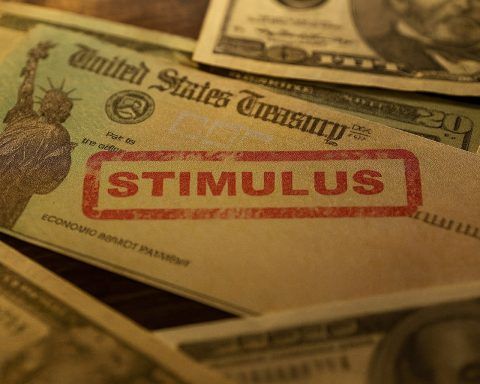- Rare visiteur interstellaire : La comète 3I/ATLAS n’est que le troisième objet connu provenant d’au-delà de notre système solaire (après 1I/ʻOumuamua en 2017 et 2I/Borisov en 2019)space.comscience.nasa.gov. Elle a été découverte le 1er juillet 2025 par le relevé ATLAS au Chili et confirmée interstellaire par sa trajectoire extrêmement hyperboliquescience.nasa.goven.wikipedia.org. Ce visiteur glacé ne représente aucune menace pour la Terre, ne s’approchant jamais à moins de ~1,8 UA (170 millions de miles)science.nasa.govscience.nasa.gov.
- Ultra-rapide & hyperbolique : 3I/ATLAS traverse le système solaire à une vitesse record – environ 220 000 km/h (61 km/s) par rapport au Soleillivescience.comfuturism.com. Sa trajectoire est fortement hyperbolique et presque dans le plan des planètes (inclinaison ~5°), confirmant qu’il s’agit d’un intrus interstellaire en voyage aller simple hors de notre systèmeen.wikipedia.orgen.wikipedia.org.
- Éclaircissement inattendu : Alors qu’il passait autour du Soleil (périhélie le 29 octobre 2025), 3I/ATLAS s’est éclairci bien plus rapidement que prévu, déconcertant les astronomesspace.comfuturism.com. Des observations réalisées par des sondes solaires (NASA STEREO, ESA SOHO, NOAA GOES-19) ont révélé que la luminosité de la comète a augmenté de façon spectaculaire, dépassant les comètes typiques à environ deux fois le rythme habituelsciencealert.comsciencealert.com. « La raison de l’éclaircissement rapide de 3I… reste inconnue, » ont écrit les astrophysiciens Qicheng Zhang et Karl Battams dans un nouvel articlespace.com.
- Lueur bleue & dégazage vigoureux : Près du périhélie, 3I/ATLAS paraissait nettement plus bleue que la lumière du Soleil – un signe révélateur que des gaz (et pas seulement de la poussière) contribuaient fortement à sa lueursciencealert.comfuturism.com. En fait, même lorsqu’elle se trouvait à plus de 3× la distance Terre-Soleil, elle éjectait déjà de la vapeur d’eau à environ 40 kg par seconde – « comme un tuyau d’incendie à plein débit, » selon une étude récentewired.comwired.com. Cette comète est exceptionnellement « active », enrichie en glaces volatiles : le télescope spatial James Webb de la NASA (JWST) et d’autres instruments ont détecté une abondance de dioxyde de carbone gazeux, ainsi que de la vapeur d’eau, du monoxyde de carbone, du cyanure et d’autres gaz typiques de comète s’échappant du noyauen.wikipedia.orgen.wikipedia.org.
- Capsule temporelle ancienne : Des analyses suggèrent que 3I/ATLAS pourrait avoir des milliards d’années – peut-être plus vieux que notre Système solaire âgé de 4,6 milliards d’années. Des études dynamiques le ramènent jusqu’au lointain disque galactique de la Voie lactée : « 3I/ATLAS est un objet très ancien… son origine appartient à la frontière du disque mince [galactique] », explique Xabier Pérez-Couto, dont l’équipe a découvert qu’il proviendrait probablement de la population stellaire ancienne de la Voie lactéelivescience.comlivescience.com. Une estimation place son âge à près de 10 milliards d’annéeslivescience.com, ce qui en ferait la comète la plus ancienne jamais observéelivescience.com. Voyager pendant des éons à travers l’espace interstellaire l’a probablement modifiée : le bombardement par les rayons cosmiques pendant des millions/milliards d’années a donné à 3I/ATLAS une épaisse croûte externe irradiée qui « ne ressemble plus au matériau de son système stellaire d’origine »livescience.comlivescience.com.
- Examen scientifique intense : Des astronomes du monde entier saisissent l’« opportunité unique dans une vie » d’étudier cette comète étrangère. De nombreux télescopes (Hubble, JWST, SPHEREx, grands observatoires terrestres) ont observé 3I/ATLAS, et même des sondes spatiales en route vers d’autres mondes prévoient de collecter des données. Fin octobre–début novembre 2025, la sonde Hera de l’ESA et la sonde Europa Clipper de la NASA étaient prêtes à traverser la queue de la comète, pouvant potentiellement échantillonner ses gaz et plasma interstellaires lors de son passageen.wikipedia.orglivescience.com. Maintenant que 3I/ATLAS est sorti de derrière le Soleil (début novembre 2025), les astronomes ont pris les premières images post-périhélie et signalent qu’elle est visible dans de petits télescopes comme une faible « tache » dans le ciel de l’aubelivescience.comlivescience.com. Attendez-vous à une avalanche de nouvelles découvertes dans les mois à venir, alors que les chercheurs étudient sa composition, sa rotation et toutes les surprises qu’elle pourrait encore réserver. « Pas un vaisseau spatial extraterrestre » : Malgré quelques spéculations sensationnalistes au début (un article non évalué par des pairs en juillet a même avancé que 3I/ATLAS pourrait être « possiblement hostile » technologie extraterrestre), les experts rejettent fermement cette idéelivescience.comlivescience.com. « Toutes les preuves indiquent qu’il s’agit d’une comète ordinaire éjectée d’un autre système solaire », déclare l’astrophysicienne Samantha Lawlerlivescience.com. Des dizaines d’observations montrent une chevelure et une queue cométaires normales, et le JWST a confirmé la présence de composés chimiques familiers des comètes (CO₂, H₂O, etc.)en.wikipedia.org. « Toute suggestion selon laquelle il s’agirait d’un objet artificiel est une absurdité totale… une insulte au travail passionnant mené pour comprendre cet objet », a déclaré l’astronome d’Oxford Chris Lintott aux journalisteslivescience.com. En résumé, 3I/ATLAS se comporte exactement comme une comète naturelle – simplement une comète qui s’est formée autour d’une autre étoile. Comme le souligne l’expert des comètes Darryl Seligman : « De nombreuses observations télescopiques [montrent] qu’elle présente les signatures classiques de l’activité cométaire »livescience.com.
Un visiteur d’au-delà du système solaire
En juillet 2025, des astronomes ont découvert quelque chose d’extraordinaire : une comète faible et floue fonçant vers le système solaire interne sur une trajectoire non liée au Soleil. Des observations complémentaires ont confirmé que cet objet – désormais nommé 3I/ATLAS (pour le relevé ATLAS qui l’a découvert) – suivait une trajectoire hyperbolique, ce qui signifie qu’il venait de l’espace interstellaire et repartirait bientôt pour toujoursscience.nasa.goven.wikipedia.org. La désignation « 3I » indique qu’il s’agit du troisième objet interstellaire jamais observé, après l’astéroïde 1I/ʻOumuamua et la comète 2I/Borisovscience.nasa.gov. Contrairement à ʻOumuamua (qui était petit, de forme étrange et ne montrait aucune chevelure), 3I/ATLAS a immédiatement présenté un comportement typique de comète – un nuage diffus de gaz et de poussière autour d’un noyau glacéscience.nasa.gov. Cela l’a clairement classé comme une comète interstellaire, semblable à Borisov (qui a visité en 2019)space.com.Pourquoi 3I/ATLAS est-il si important ? Les objets interstellaires sont en quelque sorte des visiteurs extraterrestres – formés autour d’autres étoiles et ne faisant que passer dans notre système solaire. Ils offrent une occasion unique d’étudier la chimie et les conditions de systèmes stellaires lointains sans quitter la Terre. « Lorsque nous détectons de l’eau – ou même sa faible signature UV, OH – d’une comète interstellaire, nous lisons un message venu d’un autre système planétaire, » a déclaré le physicien Dennis Bodewits à propos de la détection d’eau par 3I/ATLASwired.comwired.com. En d’autres termes, 3I/ATLAS est un messager venu d’un autre monde, porteur d’indices sur les ingrédients et les processus de son lieu de naissance.
Découverte et confirmation
La comète 3I/ATLAS a été repérée pour la première fois le 1er juillet 2025 par les télescopes ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) à Río Hurtado, Chiliscience.nasa.gov. En moins d’une journée, des observatoires du monde entier et dans l’espace se sont intéressés à la cible. Son orbite a rapidement été calculée et s’est révélée extrêmement excentrique (avec une excentricité >> 1) – une hyperbole ouverte indiquant une origine interstellaireen.wikipedia.org. « Elle ne suit pas une trajectoire orbitale fermée autour du Soleil… retracée dans le passé, la comète provient clairement de l’extérieur de notre système solaire, » a noté la NASA dans une fiche d’informationscience.nasa.gov. Lors de sa découverte, 3I/ATLAS se trouvait déjà à l’intérieur de l’orbite de Jupiter (~4 UA du Soleil) et se dirigeait vers l’intérieurscience.nasa.gov.
Fait notable, les chercheurs ont ensuite réalisé que la comète avait été capturée de façon fortuite dans des données avant juillet : le chasseur de planètes TESS de la NASA, par exemple, avait imagé 3I/ATLAS dès mai 2025 (lorsqu’elle se trouvait à ~3 UA) et a constaté qu’elle était déjà activelivescience.comlivescience.com. Ces observations antérieures à la découverte ont montré une comète « active » de façon inattendue même dans les régions froides extérieures – un avant-goût des surprises à venirlivescience.comwired.com.
Depuis sa découverte, les astronomes se sont vivement intéressés à la composition et à l’origine de 3I/ATLAS. Les premiers spectres obtenus en juillet ont donné des indices fascinants : la comète semblait exceptionnellement riche en molécules à base de carbone et peut-être pauvre en la signature habituelle de vapeur d’eau (du moins au début)en.wikipedia.orgen.wikipedia.org. Certains ont émis l’hypothèse que cela pouvait signifier une chimie exotique, ou peut-être que la comète était trop éloignée du Soleil pour que l’eau puisse encore sublimer – ce n’est qu’ultérieurement, en s’approchant, que l’eau deviendrait détectableen.wikipedia.org. En effet, à mesure que la comète s’est rapprochée, des signatures de eau et d’OH (hydroxyle) ont été détectées par le télescope spatial Swift de la NASA fin juilleten.wikipedia.org, et du gaz cyanure (CN) ainsi qu’une trace de vapeur de nickel sont même apparus en août grâce au Very Large Telescopeen.wikipedia.org. Ce sont là des ingrédients courants des comètes, ce qui confirme que 3I/ATLAS est chimiquement similaire aux comètes familièresen.wikipedia.org – et non un objet totalement étrange – même si son mélange exact de volatils et le moment de leur libération ont été inhabituels.
Une comète ancienne venue de la frontière galactique
L’une des questions les plus passionnantes est : d’où vient 3I/ATLAS ? Les scientifiques ne peuvent pas identifier une étoile précise, mais ils peuvent déduire beaucoup de choses à partir de sa trajectoire et de sa vitesse. Il se déplace à une vitesse extraordinairement élevée – environ 61 km/s par rapport au Soleil même très loin, la vitesse la plus rapide jamais enregistrée pour une comèteen.wikipedia.orglivescience.com. Une telle vitesse signifie probablement qu’il voyage depuis des milliards d’années, propulsé par la gravité de plusieurs étoiles au fil du tempslivescience.com. En modélisant sa trajectoire d’arrivée à travers la galaxie, les chercheurs n’ont trouvé aucune rencontre rapprochée avec des étoiles proches au cours des quelques millions d’années passées – ce qui suggère qu’il vient de bien au-delà de notre voisinage stellairelivescience.comlivescience.com. En fait, une étude récente dirigée par X. Pérez-Couto a retracé l’orbite de 3I/ATLAS en arrière sur ~4,3 millions d’années en utilisant les données Gaia de l’ESA sur les mouvements stellaires. Ils ont découvert que aucune des 62 étoiles testées ne pouvait être le soleil d’origine de la comète ni même dévier significativement sa trajectoirelivescience.comlivescience.com. Cela implique que 3I/ATLAS provient de très loin, probablement des régions extérieures de la Voie lactée. L’équipe propose qu’elle vienne de la jonction entre le disque mince et le disque épais de la galaxie – essentiellement la « frontière mystérieuse » de la jeune Voie lactéelivescience.comlivescience.com. Les étoiles du disque épais sont anciennes et pauvres en métaux (pauvres en éléments lourds)livescience.com. Si 3I/ATLAS est née autour de l’une de ces étoiles anciennes, elle pourrait facilement avoir 7 à 10 milliards d’annéeslivescience.com. À titre de comparaison, notre Soleil et les planètes ont 4,6 milliards d’années – donc cette comète pourrait s’être formée lorsque la galaxie elle-même était jeune. Dans des interviews avec les médias, Pérez-Couto l’a dit sans détour : « [C’est] un objet très ancien… son origine appartient à la frontière du disque mince », ce qui signifie qu’elle provient probablement d’un système stellaire primordial de la jeunesse de la galaxielivescience.com. Cet âge incroyable ferait de 3I/ATLAS une capsule temporelle de l’histoire cosmique. Cependant, paradoxalement, il se peut qu’elle ne conserve pas les ingrédients vierges de sa naissance. Pourquoi ? Parce qu’errer dans l’espace interstellaire pendant des éons a transformé l’extérieur de la comète. Les rayons cosmiques galactiques – un rayonnement à haute énergie omniprésent dans l’espace interstellaire – ont bombardé les glaces de la comète pendant des millions ou des milliards d’années, déclenchant des changements chimiques. Une nouvelle étude utilisant des données du JWST a révélé que la chevelure de 3I/ATLAS est extrêmement riche en dioxyde de carbone (CO₂)livescience.com. Au premier abord, on pourrait penser que cela signifie que la comète s’est formée dans une région très froide (au-delà de la ligne de gel du CO₂ de son étoile d’origine). Mais l’étude, dirigée par R. Maggiolo, conclut que la majeure partie de ce CO₂ est en réalité un sous-produit des rayons cosmiques convertissant d’autres glaces (comme le CO) en CO₂ sur de longues périodeslivescience.com. Essentiellement, 3I/ATLAS a développé une croûte irradiée de 15 à 20 mètres d’épaisseur de matière transformée à sa surfacelivescience.comlivescience.com. « C’est très lent, mais sur des milliards d’années, c’est un effet très fort, » explique Maggiolo, notant que les couches externes de la comète ressemblent probablement peu à la glace d’origine dont elle s’est forméelivescience.com. L’équipe de recherche qualifie cela de « changement de paradigme » – les comètes interstellaires pourraient être principalement recouvertes de crasse galactique, et non de glace primordiale viergelivescience.com. Selon Maggiolo, « des objets comme la comète 3I/ATLAS sont principalement constitués de matière transformée par les rayons cosmiques plutôt que de matière vierge… provenant de leur lieu de formation »livescience.com. Concrètement, cela signifie que les scientifiques devront travailler davantage pour déduire la composition d’origine de la comète – ils devront peut-être regarder sous cette croûte irradiée (par exemple, en observant les gaz libérés maintenant qu’elle est plus proche du Soleil et qu’elle perd peut-être des couches).Quoi qu’il en soit, l’âge extrême et l’origine galactique de 3I/ATLAS le rendent profondément intéressant. Si il s’est réellement formé il y a environ 10 milliards d’années dans un système stellaire primitif, il porte en lui des indices fossiles sur la formation des planètes et des comètes dans la jeune Voie lactée. Même si sa surface est altérée, son noyau pourrait encore préserver des glaces anciennes. Comme l’a dit un astronome, étudier 3I/ATLAS est « une précieuse capsule temporelle de l’ancienne Voie lactée »livescience.comlivescience.com.
Voyage à travers notre système solaire
En entrant dans le système solaire interne, 3I/ATLAS a suivi une trajectoire alignée de façon fortuite avec le plan des planètes (presque coplanaire avec l’orbite de la Terre, mais dans une direction rétrograde, inclinée d’environ 175°)en.wikipedia.org. Il s’est approché depuis la direction de la constellation du Sagittaire (près de la direction du centre galactique)science.nasa.gov. Fin septembre 2025, la comète est devenue inobservable depuis la Terre en raison de son angle proche du Soleil (conjonction solaire)en.wikipedia.org. En octobre, elle se trouvait de l’autre côté du Soleil par rapport à la Terre, effectuant son approche la plus proche du Soleil – périhélie – le 29 octobre 2025 à environ 1,4 UA du Soleil (juste à l’intérieur de l’orbite de Mars)science.nasa.goven.wikipedia.org.
Au périhélie, 3I/ATLAS était encore une comète lointaine selon les critères habituels – elle ne s’est jamais approchée à moins de ~200 millions de km du Soleilscience.nasa.gov. À titre de comparaison, de nombreuses comètes plongent bien à l’intérieur de 1 UA. Ainsi, 3I/ATLAS n’est pas devenue un objet visible à l’œil nu ; au mieux, elle a atteint une magnitude d’environ ~9–10 (une cible pour de bons télescopes amateurs)livescience.comlivescience.com. Cependant, étant presque directement derrière le Soleil, elle était totalement cachée de la vue depuis la Terre durant les semaines cruciales autour du périhéliesciencealert.com. Les astronomes se sont préparés à attendre jusqu’en décembre 2025, lorsque la comète réapparaîtrait dans le ciel avant l’aube sur Terrespace.comscience.nasa.gov.Heureusement, des ressources spatiales sont venues à la rescousse. Plusieurs sondes d’observation solaire ont réussi à suivre 3I/ATLAS autour du Soleil. À la mi-octobre, l’astronome amateur Worachate Boonplod a repéré la comète dans les données en temps réel du satellite météorologique GOES-19 de la NOAA, qui est équipé d’un coronographelivescience.comlivescience.com. « La comète se déplace de la gauche vers la droite… et devrait sortir du champ [GOES] le 24 octobre », a-t-il noté en observant son point flou sur les images du coronographelivescience.comlivescience.com. L’Observatoire des relations solaires et terrestres de la NASA (STEREO-A et -B) a également capturé 3I/ATLAS, tout comme le coronographe LASCO de la sonde SOHOspace.comlivescience.com. Ce réseau improvisé de suivi du système solaire a permis aux scientifiques de ne pas perdre 3I/ATLAS de vue – ils ont suivi chacun de ses mouvements à travers le périhélie grâce à ces yeux spatiaux.
L’une des grandes surprises est survenue lorsque la comète a atteint le périhélie : ces observations des sondes spatiales ont révélé une explosion inattendue de luminosité. Les comètes deviennent normalement plus brillantes à mesure qu’elles s’approchent du Soleil (la lumière solaire vaporise leurs glaces, libérant de la poussière réfléchissante), mais l’augmentation de luminosité de 3I/ATLAS était bien plus abrupte que la normale. Entre la mi-septembre et la fin octobre (alors qu’elle passait d’environ 2 UA à 1,36 UA du Soleil), sa luminosité a suivi une courbe extrêmement raide – à peu près proportionnelle à l’inverse de la distance^7,5 selon Zhang et Battamssciencealert.comsciencealert.com. Typiquement, une comète pourrait voir sa luminosité augmenter avec une dépendance d’environ r^-2 à r^-4. Doubler le taux d’augmentation de luminosité attendu a amené les scientifiques à soupçonner qu’il se passait quelque chose d’inhabituel. « Ce visiteur interstellaire devient plus lumineux à un rythme environ deux fois supérieur au taux typique, ce qui suggère qu’il se passe quelque chose d’inhabituel à sa surface », a rapporté ScienceAlert/Universe Todaysciencealert.com. Au périhélie, 3I/ATLAS était environ 10× plus brillante que ce que les premières prévisions avaient supposé.
Le grand mystère de la luminosité
L’augmentation rapide de la luminosité de la comète 3I/ATLAS à l’approche du Soleil est devenue l’un des sujets de recherche les plus brûlants. Pourquoi est-elle devenue si brillante si vite ? À ce stade, personne n’en est certain – mais les scientifiques ont des idées. « La raison de l’augmentation rapide de la luminosité de 3I, qui dépasse largement le taux d’augmentation de la plupart des comètes du nuage d’Oort à des distances similaires, reste inconnue », ont écrit Q. Zhang et K. Battams dans leur prépublication du 28 octobrespace.com. Eux et d’autres proposent quelques explications possibles :
- Composition ou structure unique : 3I/ATLAS pourrait avoir des propriétés intrinsèques différentes de celles des comètes typiques. Par exemple, peut-être que ses glaces de surface sont différentes, ou qu’il possède une croûte fragile et fracturée. « Des particularités dans les propriétés du noyau comme la composition, la forme ou la structure — qui pourraient avoir été acquises dans son système d’origine ou au cours de son long voyage interstellaire — peuvent également contribuer [à l’augmentation rapide de la luminosité], » ont noté Zhang et Battamsspace.comspace.com. En d’autres termes, quelque chose dans la composition de la comète (peut-être un composé volatil qui s’est « enflammé » à une certaine distance, ou un effondrement structurel exposant de la glace fraîche) pourrait avoir provoqué une poussée d’activité.
- Vitesse immense : Son extrême vélocité pourrait jouer un rôle. Voyageant si rapidement, 3I/ATLAS a subi un changement très rapide de chauffage solaire – elle est passée de 2 UA à 1,4 UA en peu de temps. Cela pourrait avoir intensifié son dégazage. « D’une part, cela pourrait être l’immense vitesse de l’objet, » ont suggéré les chercheurs à propos de l’augmentation rapide de la luminositéfuturism.com. L’approche rapide pourrait avoir causé une sorte de choc thermique à la surface de la comète.
- Domination du dioxyde de carbone : Les observations indiquent que l’activité de 3I/ATLAS au périhélie était dominée par le CO₂ plutôt que par l’eauspace.com. Normalement, vers ~1,4 UA, la sublimation de l’eau devient le principal moteur de la chevelure d’une comète. Mais dans ce cas, il semble que le CO₂ (qui se sublime à des températures plus basses) était encore un contributeur majeur même à cette distancespace.com. Une idée est qu’un dégazage intense de CO₂ peut en réalité refroidir la surface de la comète (la sublimation du CO₂ emporte la chaleur), retardant ainsi le début d’une sublimation vigoureuse de la glace d’eauspace.comspace.com. Cela pourrait créer un profil de luminosité différent de celui attendu. Zhang/Battams mentionnent que la comète « était encore dominée par la sublimation du dioxyde de carbone à une distance inhabituellement proche… entraînant un refroidissement qui… a supprimé la sublimation de la glace d’eau »space.com. Cette thermodynamique atypique pourrait être liée au pic de luminosité.
- Fragmentation ou jets : Il est également possible que le noyau ait perdu un fragment ou développé un nouveau jet de matière. Un jet concentré de poussière/gaz en direction du Soleil pourrait considérablement augmenter la luminosité de la comète sur les images prises depuis le Soleil. (En fait, certaines images montraient un « gigantesque jet » pointant vers le Soleillivescience.com.) Si un morceau de la croûte s’est fissuré, exposant de nouveaux réservoirs de volatils, cela pourrait provoquer une flambée d’activité.
Une caractéristique très intéressante des données du périhélie était la couleur de la comète. Les observations spatiales ont montré que 3I/ATLAS apparaissait nettement bleue sur les images du coronographelivescience.comsciencealert.com. Les comètes peuvent avoir différentes couleurs selon le mélange de gaz et de poussière – la poussière réfléchit la lumière du soleil avec une teinte plus rougeâtre, tandis que les gaz ionisés brillent souvent en bleu ou en vert (par exemple, le gaz CN produit une lueur bleue, le gaz C₂ une lueur verte). La teinte bleue de 3I/ATLAS suggérait fortement que les émissions gazeuses contribuaient largement à sa luminositélivescience.comsciencealert.com. En d’autres termes, nous voyions du gaz lumineux (excité par le rayonnement solaire) plutôt que la simple lumière du soleil réfléchie par la poussière. Cela correspond à une comète subissant une forte sublimation de ses volatils.
En effet, les spectres de cette période ont révélé la présence de gaz tels que le cyanogène (CN) et possiblement l’ammoniac contribuant à la coloration inhabituellesciencealert.comsciencealert.com. Au début, lors de son approche, la poussière de la comète avait été observée comme étant rougeâtre (probablement en raison de grains riches en matières organiques, comme pour de nombreuses comètes)sciencealert.com. Le passage à une teinte plus bleutée a été « particulièrement remarquable », rapporte Universe Today, indiquant une phase d’éclaircissement due aux gazsciencealert.com. La chevelure (coma) fin octobre était grande et très gazeuse – le coronographe de GOES-19 a pu directement distinguer la tête floue de la comète comme un objet étendu d’environ 4 minutes d’arc de large (soit des dizaines de milliers de kilomètres de diamètre)sciencealert.com. Cette enveloppe lumineuse et étendue montre à quel point active 3I/ATLAS est devenue en recevant un ensoleillement accru. Pour mettre l’activité de la comète en perspective : des observations réalisées par le télescope spatial UV Swift de la NASA (et une analyse ultérieure publiée dans Astrophysical Journal Letters) ont révélé que même à 2,9 UA du Soleil (bien au-delà de Mars), 3I/ATLAS libérait déjà d’énormes quantités d’eau. Elle perdait du H₂O à un rythme estimé à 40 kg/s à cette distancewired.comwired.com. « Déjà à cette distance… 3I/ATLAS fuyait de l’eau à environ 40 kilogrammes par seconde, un débit comparable à une bouche d’incendie à pleine puissance, » a rapporté Wired, citant les auteurs de l’étudewired.comwired.com. Ce taux est remarquable – les comètes aussi éloignées sont généralement peu actives, commençant à peine à se réchauffer. 3I/ATLAS, cependant, s’est comportée comme une bouche d’incendie dans l’espace profond. Une possibilité est qu’elle possède une surface très poreuse ou en fragmentation, permettant à la glace d’eau de sublimer précocement (ou à de petits grains de glace de se détacher et de se vaporiser)wired.com. Une autre idée est que son long voyage interstellaire lui a laissé un manteau très riche en volatils (comme le CO, le CO₂, etc., qui peuvent déclencher des processus secondaires libérant de l’eau). Quoi qu’il en soit, l’activité de la comète avant son passage au périhélie était hors normes.« Chaque comète interstellaire jusqu’à présent a été une surprise, » a noté l’astronome Zexi Xing, co-auteur de l’étude sur l’eauwired.com. « ‘Oumuamua était sèche, Borisov était riche en monoxyde de carbone, et maintenant ATLAS libère de l’eau à une distance où nous ne nous y attendions pas. Chacune réécrit ce que nous pensions savoir sur la façon dont les planètes et les comètes se forment autour des étoiles. »wired.com Cette citation illustre bien comment 3I/ATLAS s’inscrit dans une perspective plus large : c’est la dernière étude de cas d’un échantillon très restreint d’objets interstellaires, et chacun a défié les attentes à sa manière. ʻOumuamua ne possédait pas de coma du tout (ce qui a mené à des débats sur sa nature), Borisov ressemblait à une comète normale mais avec un gaz CO inhabituellement élevé, et maintenant ATLAS est extrêmement active avec de l’eau et du CO₂ plus tôt que prévu. À mesure que les scientifiques recueillent plus de données sur 3I/ATLAS, ils espèrent comprendre si de telles différences sont dues à leurs environnements d’origine différents ou simplement à des particularités individuelles. Avec un échantillon de trois, nous ne faisons encore qu’effleurer la diversité des objets interstellaires.
De retour en vue : observations post-périhélie et perspectives
Après avoir contourné le Soleil, la comète 3I/ATLAS se dirige maintenant de nouveau vers l’extérieur du système solaire – et revient une fois de plus dans le champ de vision de la Terre. Au cours des premiers jours de novembre 2025, les observateurs ont enfin commencé à apercevoir la comète émergeant de l’éclat du Soleil à l’est avant le lever du soleillivescience.comlivescience.com. L’un des premiers à signaler une observation fut Qicheng Zhang (le chercheur de l’Observatoire Lowell et co-découvreur de l’effet de luminosité au périhélie). Le 31 octobre, utilisant le télescope Discovery Channel de 4,3 mètres de Lowell en Arizona, Zhang a pris ce qui est probablement la première image optique de 3I/ATLAS après le périhélielivescience.comlivescience.com. La photo (prise à l’aube d’Halloween) montre un faible point flou – pas grand-chose à voir, mais un trésor scientifique car elle confirme que la comète a survécu au périhélie et est de nouveau accessible. Zhang a ensuite réussi à détecter la comète avec un télescope bien plus petit de 6 pouces (15 cm), démontrant que les astronomes amateurs équipés de télescopes modestes peuvent désormais participer à la chasse à la comète interstellairelivescience.com.
« Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un ciel dégagé et d’un horizon est très bas », a conseillé Zhang aux observateurs du ciel dans un courriel à Live Sciencelivescience.com. « Ce ne sera pas très impressionnant, ce n’est qu’une tache, mais ce sera une tache de plus en plus visible au fil des prochains jours. »livescience.com En effet, chaque jour tout au long du mois de novembre, 3I/ATLAS s’éloigne du Soleil dans notre ciel, montant plus haut avant l’aube. Une à deux semaines après le 3 novembre, on s’attendait à ce qu’elle soit un objet de 25 à 30° avant l’aube, moment où de nombreux grands télescopes à travers le monde pourraient recommencer à la cibler confortablementlivescience.com.
Cette visibilité renouvelée lance une campagne d’observation cruciale. Les chercheurs peuvent désormais déployer toute la puissance des observatoires terrestres (qui surpassent généralement les télescopes spatiaux à certains égards, comme la résolution et la flexibilité) pour étudier 3I/ATLAS en détail. Ils surveilleront les variations de luminosité (est-ce que l’objet s’estompe ou présente-t-il des sursauts de rémanence ?), observeront le développement de sa chevelure et de sa queue, mesureront sa période de rotation (en étudiant les variations de la courbe de lumière) et prendront des spectres pour inventorier ses gaz.De façon excitante, même des sondes spatiales à travers le système solaire essaient de participer à l’événement. Un article d’Andy Tomaswick a souligné que deux sondes – Hera de l’ESA (en route vers un astéroïde binaire) et Europa Clipper de la NASA (en route vers Jupiter) – ont des trajectoires qui croisent la longue queue de la comète vers la fin octobre et début novembrelivescience.comlivescience.com. Le trajet d’Hera devrait croiser la queue ionique entre le 25 octobre et le 1er novembre 2025, et celui d’Europa Clipper entre le 30 octobre et le 6 novembrelivescience.comlivescience.com. Si les contrôleurs de mission pouvaient faire des observations (ce qui serait difficile, car ces sondes ont leurs propres priorités), ils pourraient échantillonner le plasma de la queue de la comète ou détecter son influence magnétique sur le vent solaire. « Ils pourraient être les premiers de l’histoire humaine à échantillonner directement la queue d’une comète interstellaire – et ce serait quelque chose dont se vanter, » a plaisanté Tomaswicklivescience.comlivescience.com. Même sans manœuvre spéciale, Europa Clipper dispose d’un instrument à plasma et d’un magnétomètre qui pourraient, par hasard, détecter des signatures en traversant la zone généralelivescience.comlivescience.com. Nous devrons surveiller les nouvelles de ces équipes de mission pour savoir si elles ont détecté quelque chose d’inhabituel. Quoi qu’il en soit, la simple possibilité souligne à quel point l’effort pour étudier 3I/ATLAS est devenu mondial et même interplanétaire.
Un autre atout clé sera le télescope spatial Hubble de la NASA, qui avait du temps d’observation prévu en novembre et décembre pour observer 3I/ATLAS dans l’ultravioleten.wikipedia.org. Hubble peut fournir des images et des spectres ultra-précis, aidant à mesurer des éléments comme la production d’eau de la comète (via l’émission Lyman-alpha ou les raies OH) et même rechercher des indices de composés organiques. Le JWST, qui a observé la comète en août, pourrait également effectuer des suivis maintenant que la comète s’éloigne – ses instruments infrarouges peuvent détecter par exemple le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone et les propriétés de la poussière avec une grande sensibilitéscience.nasa.gov. En fait, les premières données du JWST en août donnent déjà des résultats (comme mentionné, le JWST a confirmé une chevelure riche en CO₂)livescience.comlivescience.com. À mesure que la comète s’éloigne, le JWST pourrait tenter d’observer tout changement de composition après le périhélie – Maggiolo a noté l’intérêt de comparer les spectres avant et après le périhélie pour voir si de nouvelles glaces ont été exposéeslivescience.com.
D’ici la mi-2026, la comète 3I/ATLAS sera bien au-delà de la portée d’observation, repartant vers l’obscurité de l’espace interstellaire. Elle passera à environ 0,36 UA de Jupiter en mars 2026 sur sa trajectoire de sortieen.wikipedia.org, ce qui signifie de façon intrigante que des sondes autour de Jupiter (comme l’orbiteur Juno ou la future Europa Clipper une fois arrivée des années plus tard) pourraient l’apercevoir de loin. Selon la NASA, 3I/ATLAS devrait rester visible aux télescopes au moins jusqu’au début de 2026, et il est possible que certaines sondes autour de Jupiter puissent l’imager lors de son passage à proximité en mars 2026livescience.com.
Après cela, notre visiteur interstellaire repartira, en route vers le gouffre sans fin entre les étoiles. Il ne reviendra jamais – la gravité du Soleil est insuffisante pour le retenir. Mais longtemps après le départ de 3I/ATLAS, les astronomes continueront d’analyser les données qu’il nous a laissées, apprenant autant que possible sur ce vagabond cosmique.
Effervescence médiatique et spéculations sur les extraterrestres
Aucune histoire sur un visiteur interstellaire ne serait complète sans un peu d’intrigue. Dans le cas de 3I/ATLAS, cela s’est manifesté très tôt sous la forme de théories sur « vaisseau spatial extraterrestre » – un déjà-vu de la saga ʻOumuamua. À la mi-juillet 2025, un petit groupe de scientifiques (notamment l’astronome de Harvard Avi Loeb, connu pour ses spéculations sur ʻOumuamua) a publié un article suggérant que 3I/ATLAS pourrait peut-être être une sonde artificielle – voire « possiblement hostile » – déguisée en comètelivescience.comlivescience.com. L’article n’apportait aucune preuve concrète, se qualifiant lui-même « d’exercice pédagogique », mais soulignait ce que les auteurs appelaient des caractéristiques « anormales » de 3I/ATLAS (comme sa grande taille estimée et l’alignement de son orbite)livescience.comen.wikipedia.org. Cette affirmation provocante a attiré quelques gros titres et fait le buzz sur Internet.
Cependant, les astronomes traditionnels ont rapidement et fermement réfuté ces affirmations. « Les experts ont qualifié cela de ‘non-sens’ et ‘insultant’, insistant sur le fait que les preuves indiquent que l’objet est entièrement naturel », rapportait Live Science dans un article judicieusement intitulé « On recommence ! »livescience.com. Beaucoup ont estimé que les discussions sur les extraterrestres détournaient l’attention de la véritable science menée sur 3I/ATLAS. « Les astronomes du monde entier ont été ravis de l’arrivée de 3I/ATLAS… Toute suggestion selon laquelle il serait artificiel est un non-sens absolu, et c’est une insulte au travail passionnant mené pour comprendre cet objet », a déclaré l’astronome d’Oxford Chris Lintott, qui faisait partie d’une équipe étudiant les origines de la comètelivescience.com.
D’autres scientifiques ont souligné que les soi-disant « anomalies » n’étaient finalement pas si étranges. Par exemple, au début, nous n’avions pas encore détecté certains composés chimiques simplement parce que la comète était encore lointaine en juillet. « L’objet est encore assez éloigné du Soleil, donc non, nous ne nous attendrions généralement pas à trouver de preuves directes de volatils [à ce moment-là], » expliquait alors Darryl Seligmanlivescience.com. Effectivement, au fil des semaines, les télescopes ont détecté ces volatils (eau, OH, CN, etc.), confirmant que 3I/ATLAS se comportait comme une comète normale à mesure qu’elle s’approchaiten.wikipedia.org. Seligman a souligné : « Il y a eu de nombreuses observations télescopiques de 3I/ATLAS démontrant qu’elle présente des signatures classiques d’activité cométaire. »livescience.com Samantha Lawler a ajouté que « Toutes les preuves indiquent [qu’il s’agit] d’une comète ordinaire qui a été éjectée d’un autre système solaire, tout comme d’innombrables milliards de comètes ont été éjectées du nôtre »livescience.com. En résumé, rien n’exigeait une technologie extraterrestre pour expliquer cela.
Avi Loeb lui-même a tempéré son hypothèse sur son blog, admettant que « le résultat le plus probable sera que 3I/ATLAS est un objet interstellaire complètement naturel, probablement une comète » – il a défendu l’exercice comme « amusant à explorer » quoi qu’il en soiten.wikipedia.orgen.wikipedia.org. Néanmoins, beaucoup dans la communauté scientifique étaient agacés que de telles affirmations attirent l’attention. « Des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires, et les preuves présentées ne sont absolument pas extraordinaires, » a déclaré Lawler, notant que cela poussait l’ouverture d’esprit à sa limitelivescience.comlivescience.com.
D’ici la fin de 2025, les discussions sur les extraterrestres s’étaient en grande partie apaisées, la nature cométaire de 3I/ATLAS étant devenue indéniable. La couverture médiatique s’est recentrée sur les surprises scientifiques de la comète – sa luminosité, sa composition, et ce qu’elle pouvait nous apprendre sur d’autres systèmes stellaires. Comme le notait un article, « Il y a eu quelques spéculations frénétiques dans les médias selon lesquelles 3I/ATLAS pourrait être un vaisseau spatial extraterrestre, mais la plupart des astronomes sont convaincus que ce visiteur interstellaire est une comète ordinaire provenant d’un système stellaire inconnu de la Voie lactée. »livescience.com Cela résume bien la situation. L’histoire réelle de 3I/ATLAS n’a pas besoin d’extraterrestres pour être palpitante – la réalité est déjà suffisamment excitante !Conclusion
La comète 3I/ATLAS s’est révélée être une merveille cosmique, de sa découverte à son passage près du Soleil. En quelques mois à peine, elle a réécrit les manuels sur les comètes interstellaires : confirmant certaines attentes (oui, c’est une comète avec des glaces familières) mais apportant aussi de nombreuses surprises (dégazage d’eau précoce sans précédent, mystérieux éclat au périhélie, indices d’une croûte irradiée, etc.). Elle nous rappelle que l’univers est plein de surprises – même une comète apparemment « ordinaire » venue d’un autre système solaire peut remettre en question notre compréhension de la formation et du comportement de ces objets.
Début novembre 2025, 3I/ATLAS entame la phase de retour de sa visite, offrant aux astronomes terrestres une dernière occasion d’étudier cet ancien voyageur. « La comète s’élève rapidement… dans une semaine… un grand nombre d’autres grands télescopes… pourront la suivre, » a noté Zhang avec enthousiasmelivescience.com. On peut s’attendre à ce que de nouvelles données continuent d’arriver : des estimations de taille plus précises (Hubble suggère que le noyau ne mesure que quelques kilomètres de large au maximumlivescience.com), des analyses détaillées de la composition grâce à la spectroscopie, et peut-être des indices sur sa rotation ou sa structure interne. Chaque information recueillie sur 3I/ATLAS est une fenêtre sur le système planétaire d’une étoile lointaine – une pièce du puzzle de la formation des comètes (et peut-être des planètes) dans des environnements très différents du nôtre.
Les objets interstellaires sont de rares cadeaux. L’humanité en a maintenant rencontré trois, et chacun a élargi notre perspective cosmique. 3I/ATLAS sera étudié pendant des années, longtemps après qu’il ait disparu de notre vue. Et qui sait – le prochain visiteur interstellaire pourrait être encore totalement différent. Comme l’a dit un chercheur à propos d’ATLAS, « Chacun réécrit ce que nous pensions savoir »wired.com. L’histoire de 3I/ATLAS est encore en train de s’écrire, mais un message est clair : notre système solaire n’est pas isolé. Nous faisons partie d’un écosystème galactique plus vaste où la matière – comètes, peut-être même des microbes, qui sait – peut voyager d’étoile en étoile. Chaque comète interstellaire comme 3I/ATLAS est un messager venu de loin, portant les secrets de son foyer. En perçant ces secrets, nous nous rapprochons de la compréhension de l’histoire plus large de notre galaxie et des origines des mondes qui s’y trouvent.
Sources :
- Space.com – « Interstellar invader Comet 3I/ATLAS is still full of surprises… » (31 oct. 2025)space.comspace.com
- ScienceAlert/Universe Today – « Interstellar Comet 3I/ATLAS’s Blue Shine Is Surprising Astronomers » (3 nov. 2025)sciencealert.comsciencealert.com
- Live Science – plusieurs rapports de P. Pester, H. Baker, B. Specktor, et al. (juillet–nov. 2025)livescience.comlivescience.comlivescience.comlivescience.com
- NASA Science – « Fiche d’information sur la comète 3I/ATLAS » (oct. 2025)science.nasa.govscience.nasa.gov
- Wired – « La comète interstellaire 3I/ATLAS crache de l’eau comme une bouche d’incendie cosmique » (14 oct. 2025)wired.comwired.com
- Prépublications académiques – Zhang & Battams (2025) sur arXivspace.comspace.com ; Maggiolo et al. (2025) sur arXivlivescience.comlivescience.com ; Pérez-Couto et al. (2025) sur arXivlivescience.comlivescience.com, etc.