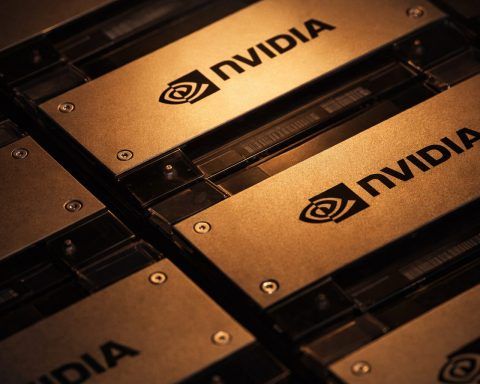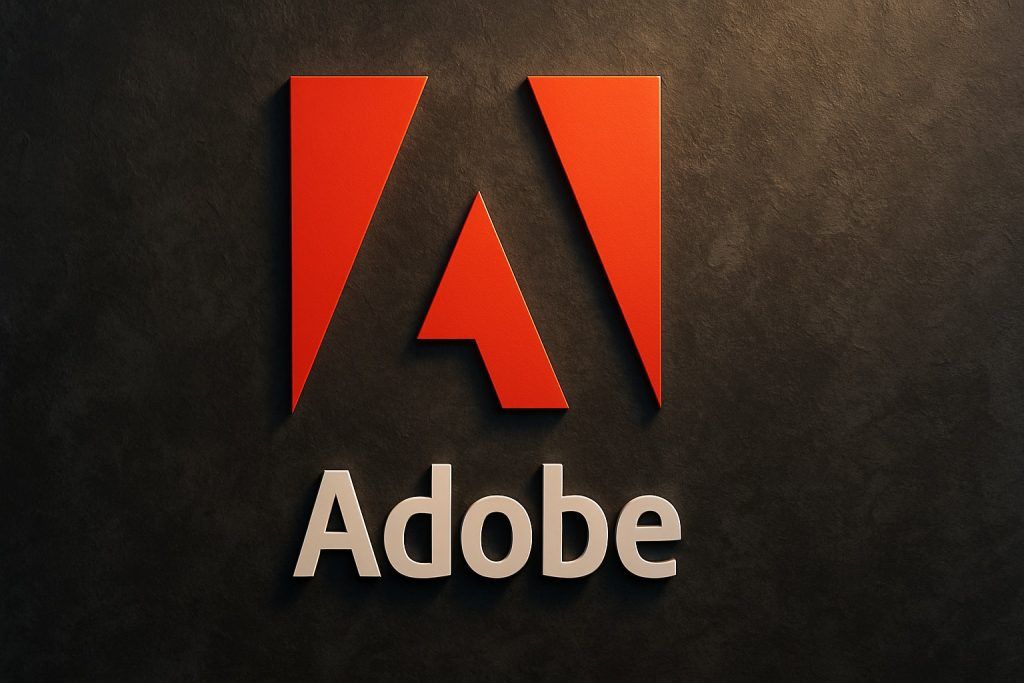Faits clés et points saillants
- Troisième visiteur interstellaire : La comète 3I/ATLAS n’est que le troisième objet connu provenant d’au-delà de notre système solaire (après 1I/‘Oumuamua en 2017 et 2I/Borisov en 2019)ts2.tech. Découverte le 1er juillet 2025 par le relevé ATLAS financé par la NASA au Chili, sa trajectoire hyperbolique non liée l’a immédiatement signalée comme interstellairets2.tech.
- Approche solaire rapprochée (29–30 octobre 2025) : Elle a atteint le périhélie (point le plus proche du Soleil) autour du 29 octobre 2025, passant à l’intérieur de l’orbite de Mars à ~1,36 UA du Soleilts2.tech. Au périhélie, elle se trouvait de l’autre côté du Soleil par rapport à la Terre, donc elle était alors inobservable depuis la Terre. Son approche la plus proche de la Terre sera d’environ 1,8 UA (270 millions de km) en décembre 2025, ne présentant aucune menace et restant trop faible pour être visible à l’œil nuts2.tech.
- Vitesse fulgurante : 3I/ATLAS traverse le système solaire interne à 58 km/s (~130 000 mi/h)ts2.tech – une vitesse extraordinaire bien supérieure à celle des comètes typiques. Sa vitesse extrême et sa trajectoire d’échappement ouverte sont des signes clairs d’une origine interstellairets2.tech.
- Taille record : Les astronomes pensent que 3I/ATLAS pourrait être le plus grand objet interstellaire détecté à ce jour. Les premières observations laissaient entendre que son noyau glacé pourrait mesurer jusqu’à quelques kilomètres de largets2.tech – bien plus grand que ‘Oumuamua (~100 m) ou Borisov (~1 km). Les images du télescope Hubble ont fixé une limite supérieure d’environ 5,6 km de diamètrets2.tech, faisant de 3I/ATLAS potentiellement un géant parmi les vagabonds interstellaires.
- Ancienne « capsule temporelle » : D’après sa trajectoire galactique, 3I/ATLAS provient probablement de la vieille population du disque épais d’étoiles de la Voie lactéets2.tech. Les chercheurs estiment qu’elle pourrait avoir 7 à 11 milliards d’années, ce qui en ferait peut-être la comète la plus ancienne jamais observée (environ 3 milliards d’années de plus que notre système solaire, âgé de 4,6 milliards d’années)ts2.tech. En d’autres termes, cette comète se serait formée bien avant notre Soleil, préservant une matière primordiale d’une ère cosmique révoluets2.tech.
- Activité inhabituelle : Même loin du Soleil, 3I/ATLAS s’est révélée étonnamment active. Le télescope spatial Swift de la NASA l’a détectée en train d’émettre de la vapeur d’eau à environ 40 kg par seconde – « à peu près l’équivalent d’une lance à incendie à pleine puissance » – alors qu’elle se trouvait encore à 2,9 UA du Soleilts2.tech. Un dégazage d’eau aussi abondant à trois fois la distance Terre-Soleil est très inhabituel, ce qui suggère la présence de glace volatile exposée précocementts2.tech.
- Composition étrange : Les spectres révèlent que la coma (halo gazeux) de 3I/ATLAS est riche en CO₂ mais pauvre en COskyandtelescope.org, ce qui signifie qu’elle a été « bien cuite et bouillie » dans son système d’origine et a perdu ses glaces les plus volatiles il y a longtempsskyandtelescope.org. Les scientifiques ont également détecté du gaz cyanure et une abondance inattendue de vapeur de nickel dans le gaz de la comèteskyandtelescope.org. Le nickel est rarement observé dans les comètes à de telles distances ; les chercheurs soupçonnent qu’il pourrait être transporté sous forme de nickel tétracarbonyle, un composé volatil de nickel et de monoxyde de carbone qui se décompose à la lumière du soleilskyandtelescope.org. Cette chimie étrange offre de nouveaux indices sur la composition de 3I/ATLAS et son voyage interstellaire.
- Campagne d’observation mondiale : Des télescopes du monde entier – et hors du monde – se sont mobilisés pour étudier 3I/ATLAS. Hubble et le James Webb Space Telescope l’ont tous deux observéskyandtelescope.org. De grands observatoires terrestres (Gemini Sud, VLT, etc.) ont imagé sa coma et sa queue. Même des sondes proches d’autres planètes ont participé : début octobre, l’orbiteur ExoMars Trace Gas Orbiter de l’ESA a photographié la comète depuis l’orbite martienne à environ 30 millions de kmesa.intesa.int. Prochainement, la sonde JUICE de l’ESA (près de Jupiter) et la sonde Psyche de la NASA (entre la Terre et Mars) sont prêtes à observer 3I/ATLAS près du périhélie sous des angles uniquests2.tech.
Un visiteur venu d’au-delà du système solaire
En juillet 2025, des astronomes ont repéré un nouveau venu faible se dirigeant vers le Soleil – un objet qui n’était pas du tout lié gravitationnellement à notre étoile. L’objet, désormais désigné 3I/ATLAS, n’est que le troisième visiteur interstellaire jamais détecté dans notre système solairets2.tech. (Le préfixe « 3I » indique qu’il s’agit du troisième objet Interstellaire.) Il a été observé pour la première fois le 1er juillet 2025 par le télescope de surveillance du ciel ATLAS à Río Hurtado, au Chili, et sa découverte a immédiatement suscité l’enthousiasme. La raison ? Son orbite était hyperbolique, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une comète périodique provenant de notre nuage d’Oort, mais plutôt d’un intrus interstellaire effectuant un voyage sans retour à travers notre voisinage cosmiquets2.tech.Les précédents objets interstellaires – l’énigmatique ‘Oumuamua en 2017 et la comète 2I/Borisov en 2019 – n’ont été que de brèves et fascinantes rencontres. 3I/ATLAS offre aux scientifiques une autre occasion rare d’étudier de près un fragment d’un système stellaire lointain. « C’est un objet provenant d’une partie de la galaxie que nous n’avons jamais vue d’aussi près auparavant », a noté l’astronome Matthew Hopkins d’Oxford, dont l’équipe avait prédit de tels objets du disque épaisras.ac.uk. En fait, d’après son orbite galactique, 3I/ATLAS pourrait provenir du disque épais de la Voie lactée – un halo d’étoiles anciennes situé bien au-dessus du plan galactiquets2.tech. Cela le rendrait extraordinairement ancien. Des modèles statistiques suggèrent que 3I/ATLAS est probablement la comète la plus ancienne jamais observéeras.ac.uk, potentiellement âgée de 7 à 10+ milliards d’années, antérieure à la formation de notre système solairets2.tech. En somme, c’est une capsule temporelle d’une époque antérieure de l’univers, errant désormais dans le royaume de notre Soleil.
Un antique bolide sur un voyage sans retour
Les visiteurs interstellaires ne s’attardent pas. Fidèle à sa réputation, 3I/ATLAS fonce à travers le système solaire interne à environ 58 km/s (plus de 210 000 km/h) par rapport au Soleilts2.tech. Pour mettre cela en perspective, il se déplace environ dix fois plus vite que la vitesse orbitale de la Terre. Une telle vitesse est nécessaire pour échapper à la gravité du Soleil – et en effet, 3I/ATLAS suit une trajectoire ouverte qui le ramènera directement dans l’espace interstellaire après ce passagets2.tech. En retraçant sa trajectoire, on constate qu’il vient de bien au-delà des confins du système solairelivemint.com. En fait, la NASA note que la comète est arrivée depuis la direction de la constellation du Sagittaire, vers le centre de la galaxielivemint.com, avant que la gravité du Soleil ne courbe sa trajectoire.
Le29 octobre 2025, 3I/ATLAS a atteint son point le plus proche du Soleil (périhélie) à environ 1,36 UA – juste à l’extérieur de la distance de l’orbite terrestrelivemint.com. Il a en fait plongé à l’intérieur de l’orbite de Mars, s’approchant à environ 203 millions de km du Soleilen.wikipedia.org. Au périhélie, la comète n’était qu’à ~13° du Soleil vue depuis la Terre, cachée dans l’éclat solaireskyandtelescope.org. Plusieurs satellites d’observation solaire l’ont cependant surveillée : par exemple, le satellite GOES-19 de la NOAA a repéré 3I/ATLAS dans ses images de coronographe comme un objet de magnitude ~11 près du Soleilskyandtelescope.org. Heureusement, la comète a survécu à sa rencontre solaire et se dirige maintenant vers l’extérieur. Sur son chemin de retour, elle effectuera son passage le plus proche de la Terre le 19 décembre 2025 – mais même alors, elle restera à une distance d’environ 1,8 UA (~1,8 UA), soit près du double de la distance Terre–Soleilskyandtelescope.org. Nous n’avons rien à craindre, comme l’a plaisanté un astronome ; ce visiteur passera discrètement devant nous pour s’enfoncer dans le videskyandtelescope.org.
Alors qu’il traverse rapidement le système solaire interne, 3I/ATLAS a également “rencontré” certaines de nos planètes (du moins en termes de croisement orbital). Il est déjà passé à environ 30 millions de km de Mars début octobre, permettant à l’orbiteur martien de l’ESA de le photographier comme un point flouesa.intesa.int. Début novembre, il passera à ~0,65 UA de Vénus, et il devrait s’approcher à environ 0,36 UA de Jupiter d’ici mars 2026 alors qu’il s’éloigneskyandtelescope.org. Ces survols relativement lointains offrent tout de même une géométrie d’observation unique. Par exemple, la sonde JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) de l’ESA tentera d’observer 3I/ATLAS en novembre 2025 juste après le périhélieesa.int. Les caméras, spectromètres et capteurs de particules de JUICE étudieront la comète à distance, et l’ESA s’attend à recevoir les données de cette campagne d’ici février 2026esa.intlivemint.comlivemint.com. C’est la première fois que plusieurs sondes autour du système solaire se coordonnent pour surveiller en temps réel une comète interstellaire – un témoignage de l’importance scientifique de 3I/ATLAS.
Des caractéristiques inhabituelles révèlent les secrets de la comète
Malgré son aura interstellaire, 3I/ATLAS est apparue au départ comme une comète à bien des égards : elle arbore une chevelure floue de gaz et de poussière et a même développé une queue à mesure que la lumière du Soleil la réchauffaitskyandtelescope.org. Au début, les astronomes ont noté qu’elle “se comportait comme une comète” – émettant des gaz, s’éclaircissant comme prévu, rien d’évidemment anormal. Cependant, à mesure que de nouvelles données arrivaient, certains traits étranges sont apparus, distinguant 3I/ATLAS des comètes ordinaires.
Un mystère était l’observation d’une « anti-queue » – une queue semblant pointer vers le Soleil au lieu de s’en éloigner. À la fin de l’été 2025, certaines images télescopiques montraient une caractéristique diffuse du côté du Soleil de la comètendtv.com. Normalement, les queues de poussière et d’ions d’une comète sont repoussées loin du Soleil par le rayonnement solaire et le vent solaire. Alors, comment du matériau pourrait-il s’écouler vers le Soleil ? L’explication la plus probable est un effet de perspective : une fine traînée de poussière le long de l’orbite de la comète (parfois appelée anti-queue) est devenue visible à mesure que la géométrie d’observation changeait. En effet, en septembre, l’anti-queue s’était retournée pour adopter l’orientation normale à mesure que l’angle de la comète changeaitndtv.com. Pourtant, cette particularité a attiré l’attention. Elle a même alimenté quelques théories imaginatives (nous y reviendrons plus tard).La découverte la plus intrigante est peut-être la composition chimique de 3I/ATLAS. Des observations du JWST (Webb) en août ont révélé une composition inhabituelle par rapport aux comètes familières : une quantité exceptionnelle de dioxyde de carbone dans la chevelure, une fraction relativement faible de glace d’eau, et étonnamment peu de monoxyde de carboneskyandtelescope.orgskyandtelescope.org. En fait, un rapport a noté que le rapport CO₂/eau est parmi les plus élevés jamais observésnewstomato.com. Cela suggère que les glaces de 3I/ATLAS ont été fortement altérées – peut-être par des éons de rayonnement cosmique ou de multiples passages rapprochés près d’étoiles – de sorte que les glaces les plus volatiles (comme le CO) se sont évaporées depuis longtemps, ne laissant que le CO₂ et l’eau, moins volatils. « Elle a été bien cuite et bouillie », comme l’a dit un scientifique, perdant ses ingrédients les plus volatils il y a longtempsskyandtelescope.org. Cela correspond à l’idée que 3I/ATLAS est ancienne et a voyagé pendant des milliards d’années à travers l’espace interstellaire hostileras.ac.uk.
Un autre élément révélateur a été la détection de éléments lourds et de métaux dans le panache de dégazage de la comète. Plus précisément, des astronomes utilisant le Very Large Telescope (VLT) au Chili ont trouvé de la vapeur de nickel (Ni) et du cyanure (CN) émanant de 3I/ATLASskyandtelescope.org. Trouver du nickel est surprenant – sur Terre, le nickel ne se vaporise qu’à des températures extrêmement élevées. Dans les profondeurs froides loin du Soleil, le nickel métallique devrait rester solide. Alors, comment le nickel apparaît-il dans la chevelure de la comète ? Les scientifiques proposent qu’il pourrait voyager sous forme moléculaire. Le tétracarbonyle de nickel (Ni(CO)_4) est un candidat : un composé volatil du nickel qui peut se former lorsque le nickel et le monoxyde de carbone se combinent, et qui se décompose sous la lumière UV pour libérer des atomes de nickelskyandtelescope.org. Sur Terre, le tétracarbonyle de nickel est connu comme un sous-produit industriel (utilisé dans le raffinage des métaux) – pas quelque chose que l’on s’attend à trouver dans l’espace. Pourtant, la présence de gaz de nickel suggère qu’une telle chimie exotique pourrait être à l’œuvre. En fait, l’analyse spectrale a détecté la combinaison caractéristique de composés de nickel et de carbone compatible avec Ni(CO)_4ndtv.comskyandtelescope.org. C’est une première pour une comète. Cela montre comment les comètes d’autres étoiles pourraient contenir des espèces chimiques jamais observées dans les comètes de notre Système solaire. De telles données aident les chercheurs à déduire les conditions de l’environnement d’origine de 3I/ATLAS. Comme l’a fait remarquer un astronome, même ces infimes traces de métal « fournissent de nouveaux indices sur la chimie de la comète et son long voyage interstellaire »ts2.tech.Le plus spectaculaire est le niveau d’activité de la comète. Même lorsqu’elle se trouvait à près de 3 UA (plus de 400 millions de km) du Soleil – à peu près sur l’orbite de Jupiter – 3I/ATLAS dégazait déjà de grandes quantités d’eau. Une équipe utilisant le Neil Gehrels Swift Observatory de la NASA a détecté de l’hydroxyle (OH) – un produit de décomposition de l’eau – indiquant une sublimation importante de glace d’eau alors que la comète était encore très éloignéewired.com. En fait, elle perdait de l’eau à environ 40 kg par seconde à cette distancewired.com. Les auteurs de l’étude ont comparé cela à une bouche d’incendie fonctionnant à plein régimewired.com. « Déjà à cette distance, cependant, 3I/ATLAS fuyait de l’eau à un rythme d’environ 40 kg/s, un débit comparable à celui d’une ‘bouche d’incendie à puissance maximale’ », a rapporté Wiredwired.com. Pour donner un ordre d’idée, les comètes typiques ne perdent pas d’eau aussi vigoureusement avant d’être beaucoup plus proches de la chaleur du Soleil. Une explication possible est que le noyau de 3I/ATLAS pourrait être en train de se fragmenter ou de perdre des morceaux de glace, exposant ainsi de la glace fraîche qui se vaporise même lorsqu’elle est relativement loin du Soleilwired.com. Ce comportement n’a été observé que chez quelques comètes extrêmes. Quelle qu’en soit la cause, cela signifie que 3I/ATLAS offre un festin de données – sa production prodigieuse de gaz et de poussière facilite l’analyse détaillée de sa composition et de son comportement par les télescopes.
Comparaisons : comment 3I/ATLAS se compare à ‘Oumuamua et Borisov
Inévitablement, 3I/ATLAS est comparée à ses deux prédécesseurs interstellaires, et les contrastes sont fascinants. Chacun des trois objets interstellaires connus s’est révélé étonnamment différent, offrant aux scientifiques trois études de cas très distinctes de visiteurs errants venus de loin.
1I/‘Oumuamua (2017) a été le tout premier objet interstellaire détecté. Il était petit (estimé à seulement ~100–200 mètres de long), avait une forme allongée ou en forme de crêpe, et surtout n’a montré aucune coma ni queue visible. Il ressemblait à un rocher stérile ou peut-être à un éclat de quelque chose. ‘Oumuamua a également montré une mystérieuse accélération non gravitationnelle – comme si quelque chose le poussait doucement – ce qui a mené à des spéculations sur un dégazage (ou même une propulsion extraterrestre). Pourtant, aucun gaz dégagé n’a été observé, laissant sa véritable nature encore débattue. Il pourrait avoir été un fragment d’une exoplanète semblable à Pluton (riche en glace d’hydrogène ou d’azote) qui se serait évaporée de façon invisiblewired.com. En résumé, ‘Oumuamua s’est comporté très différemment d’une comète normale, ce qui a alimenté toutes sortes de théories.
2I/Borisov (2019), en revanche, avait une apparence beaucoup plus familière. Découvert par l’astronome amateur Gennadiy Borisov, cet objet était sans aucun doute une comète – il avait une brillante chevelure et une queue. Les spectres ont montré qu’il contenait de la vapeur d’eau et une abondance de monoxyde de carbone, similaire aux comètes ordinaires à longue période de notre nuage d’Oort. Borisov mesurait environ 0,5–1 km de diamètre et s’est comporté essentiellement comme une comète typique, à part sa trajectoire hyperbolique provenant d’une autre étoile. Une particularité intéressante était que Borisov était très riche en monoxyde de carbone (CO) – significativement plus de CO que les comètes du système solaire en moyennewired.com. Cela laissait penser qu’il avait pu se former dans une région externe plus froide et riche en CO de son système d’origine.
Voici maintenant 3I/ATLAS, qui se forge sa propre identité unique. « Chaque comète interstellaire jusqu’à présent a été une surprise », a déclaré le Dr Zexi Xing, membre de l’équipe de découverte Swiftwired.com. « ‘Oumuamua était sèche, Borisov était riche en monoxyde de carbone, et maintenant ATLAS libère de l’eau à une distance où nous ne nous y attendions pas. Chacune réécrit ce que nous pensions savoir sur la façon dont les planètes et les comètes se forment autour des étoiles. »wired.com En effet, 3I/ATLAS semble être une comète riche en eau avec une teneur exceptionnellement élevée en CO₂, mais peu de CO – presque l’inverse de la composition de Borisov. Son activité précoce et lointaine la distingue également. Et alors que ‘Oumuamua n’a révélé ni poussière ni gaz, ATLAS en libère abondamment.
Une autre différence frappante est la taille : si le noyau de 3I/ATLAS mesure de l’ordre de 1 à 5 km, il éclipse ‘Oumuamua et dépasse même légèrement Borisovts2.tech. Cette taille (et luminosité) plus importante a permis de suivre 3I/ATLAS plus facilement pendant plusieurs mois ; en comparaison, ‘Oumuamua était si petit et rapide qu’il n’a été observé que quelques semaines, avec des données cruciales limitées. En un sens, 3I/ATLAS combine certains traits de chacun de ses prédécesseurs – c’est clairement une comète active comme Borisov, mais elle porte potentiellement les empreintes chimiques d’une origine exceptionnellement ancienne et lointaine, comme pourrait l’avoir ‘Oumuamua. Avec désormais trois points de données, les astronomes commencent à saisir la diversité des objets interstellaires : aucun ne se ressemble, ce qui laisse supposer des conditions de formation très différentes autour d’étoiles variéeswired.com. Cela rend chaque nouveau visiteur immensément précieux. Comme l’a dit un chercheur, ces comètes errantes sont des “messages d’un autre système planétaire” – chacune apportant des indices uniques. “Lorsque nous détectons de l’eau — ou même son faible écho ultraviolet, OH — d’une comète interstellaire, nous lisons un message d’un autre système planétaire,” a déclaré l’astrophysicien Dennis Bodewits, qui a étudié les émissions d’eau de 3I/ATLAS. “Cela nous indique que les ingrédients de la chimie de la vie ne sont pas uniques à notre propre système.”wired.com
Artefact extraterrestre ? Spéculations d’experts et rumeurs publiques
Chaque fois qu’un objet céleste inhabituel est repéré, surtout s’il vient d’au-delà de notre système solaire, il est presque inévitable que des murmures d’“extraterrestres” suivent. 3I/ATLAS n’a pas fait exception – en fait, il est arrivé au milieu d’une vague de rumeurs en ligne et de commentaires spéculatifs sur sa véritable nature. Certains de ces propos ont été alimentés par les bizarreries de l’objet (comme cette queue pointant vers le Soleil et le composé de nickel “industriel” dans sa chevelure) qui semblaient défier toute explication simple. Fin octobre, les réseaux sociaux fourmillaient de théories farfelues : une sonde alien clandestine utilisant le Soleil pour une assistance gravitationnelle, un engin extraterrestre dormant “se réveillant” au périhélie, etc.skyandtelescope.org. Des affirmations infondées ont même suggéré que la NASA était en panique ou que l’approche de la comète était “potentiellement catastrophique”, ce qui n’avait aucun fondementskyandtelescope.org.
En entrant dans cette mêlée, un scientifique notable qui a envisagé l’hypothèse extraterrestre est l’astrophysicien de Harvard Avi Loeb. Le Dr Loeb, connu pour son ouverture à considérer la technologie extraterrestre (il a notamment émis l’hypothèse que ‘Oumuamua pourrait être une voile solaire alien), a exposé les raisons pour lesquelles il trouve le comportement de 3I/ATLAS intrigant. Dans un commentaire récent, il a souligné l’inversion de l’anti-queue et la composition riche en nickel comme des signes possibles d’une origine non naturellendtv.comndtv.com. Par exemple, l’anti-queue précoce (matériau dirigé vers le Soleil) qui s’est ensuite transformée en queue normale pourrait, selon Loeb, être analogue à un vaisseau spatial freinant puis se mettant en roue libre. Si 3I/ATLAS était un engin extraterrestre ralentissant près du Soleil, on pourrait s’attendre à ce que du matériau soit éjecté dans la direction opposée au début (une « poussée de freinage »), qui cesserait après la manœuvre, permettant la formation d’une queue normale. « Mon collègue a fait remarquer que si l’objet est un vaisseau spatial alien en train de ralentir, et que l’anti-queue est une poussée de freinage, alors ce changement d’anti-queue à queue serait tout à fait attendu près du périhélie, » a noté Loeb, suggérant qu’une telle transition « constituerait une technosignature…indiquant une manœuvre contrôlée. »ndtv.comndtv.com Loeb a également souligné la détection de nickel tetracarbonyl – une molécule associée aux procédés industriels – comme un indice potentiel de “matériaux conçus” dans la comètendtv.comndtv.com. Le fait que le nickel soit présent sans fer correspondant (normalement Ni et Fe se trouvent ensemble dans le matériau météoritique) est en effet inhabituelndtv.com. Pour Loeb, un panache riche en nickel et un grand objet chargé d’anomalies soulèvent la question de savoir si 3I/ATLAS pourrait être une sorte de technologie ou de sonde extraterrestre. Dans un article énumérant ses arguments, il a même cité le diamètre important de la comète (il a spéculé ~12 miles, bien que d’autres estiment <6 km) et sa vitesse extraordinaire comme “sans précédent pour des débris interstellaires”ndtv.comndtv.com. Il convient de noter que de nombreux pairs de Loeb considèrent que ces caractéristiques peuvent s’expliquer par des processus cométaires naturels (par exemple, la vapeur de nickel via la chimie Ni(CO)_4, comme discuté, et les anti-queues comme un phénomène connu). La plupart des scientifiques restent fortement sceptiques quant à toute hypothèse artificielle, s’appuyant sur le rasoir d’Occam pour considérer que 3I/ATLAS est une comète naturelle jusqu’à preuve du contraire. Les observations inhabituelles jusqu’à présent sont enthousiasmantes, mais elles restent dans le domaine de la science des comètes : par exemple, d’autres comètes ont déjà présenté des anti-queues temporaires et même des traces de métaux (des vapeurs de nickel et de fer ont d’ailleurs été détectées dans certaines comètes très froides du système solaire)space.comskyandtelescope.org. Aucune preuve directe d’un comportement non naturel (comme des communications, une propulsion ou des changements de trajectoire) n’a été observée. En fait, la trajectoire de la comète correspond parfaitement à la physique gravitationnelle – aucune déviation inexpliquée n’a été notée dans sa trajectoire qui suggérerait un changement de cap actifndtv.com. Il n’est pas non plus trop surprenant qu’une vieille comète interstellaire puisse présenter une chimie inhabituelle ; comme nous l’avons vu, la composition de 3I/ATLAS peut s’expliquer par sa formation et sa longue évolution dans l’espaceskyandtelescope.org.Néanmoins, la communauté scientifique ne rejette pas les données à l’origine de ces spéculations. Elle recueille avec empressement davantage de mesures au périhélie et au-delà pour « mettre les points sur les i et les barres sur les t », comme l’a formulé NDTVndtv.comndtv.com. Les missions Hubble, Webb, Parker Solar Probe de la NASA, ainsi que d’autres, suivent de près 3I/ATLAS afin de percer sa véritable naturendtv.comndtv.com. Les observations à venir (y compris celles de JUICE et peut-être même de New Horizons de la NASA, qui tentera des observations à distance) permettront de tester les hypothèses concernant la symétrie du dégazage de la comète, sa rotation et d’éventuelles anomalies. Jusqu’à présent, 3I/ATLAS se comporte comme une comète, et non comme un engin – ses sursauts et la dynamique de sa queue s’inscrivent dans la physique des comètes (même si parfois à l’extrême). Comme l’a noté avec ironie un rapport, « Si 3I/ATLAS change de direction ou connaît une flambée de luminosité, nous le saurons. Jusqu’à présent, elle se comporte comme une comète. »spaceweatherarchive.com. Et il est important de souligner que la NASA confirme qu’elle ne représente aucune menace pour la Terre, restant à des dizaines de millions de kilomètres lors de son approche la plus prochendtv.com.
L’imagination du public, cependant, a bel et bien été captivée. Des vidéos inquiétantes sur YouTube aux discussions animées sur Reddit, 3I/ATLAS est devenu un sujet tendance à la fin octobre 2025. Les grands médias ont su équilibrer l’enthousiasme par des messages rassurants : non, ce n’est pas un vaisseau-mère extraterrestre, et non, il ne percutera pas la Terrendtv.com. Mais le simple fait qu’un fantôme venu d’une autre étoile se trouve actuellement dans notre voisinage cosmique est en soi palpitant. Comme l’a dit Bob King de Sky & Telescope, il faudrait mettre de côté les théories du complot et « s’émerveiller de ce que nous savons sur cet objet unique. »skyandtelescope.org
Intérêt scientifique et perspectives
Pour les astronomes, 3I/ATLAS est un cadeau qui continuera à fournir des données pendant des mois. Sa luminosité et sa visibilité prolongée offrent une opportunité sans précédent d’étudier en profondeur une comète interstellaire. Contrairement à ‘Oumuamua (qui n’a été observé que brièvement et de loin), 3I/ATLAS est sous observation depuis de nombreux mois, et restera observable jusqu’au début de 2026 avec des télescopes. Alors qu’elle émerge maintenant de l’éclat du Soleil dans le ciel avant l’aube, les astronomes amateurs se préparent à l’observer. Vers la mi-novembre 2025, 3I/ATLAS devrait devenir accessible dans le ciel du matin terrestre (dans la constellation de la Vierge, puis du Lion) à une magnitude d’environ 10 à 11skyandtelescope.orgskyandtelescope.org. C’est trop faible pour l’œil nu, mais à la portée des télescopes d’amateur d’environ 20 cm d’ouverture ou plusskyandtelescope.org. Si elle s’éclaircit un peu plus, elle pourrait devenir une cible facile pour les astrophotographes utilisant des caméras sensibles. Les observateurs du ciel espèrent un beau spectacle ; par exemple, autour du 16 novembre, la comète devrait monter à ~20° au-dessus de l’horizon est avant l’aube pour les latitudes moyennes de l’hémisphère nord, en faisant un objet matinal intéressantskyandtelescope.org. Bien que personne ne s’attende à un spectacle éblouissant (elle ne sera pas comme une grande comète illuminant le ciel), pouvoir observer personnellement un visiteur d’un autre système stellaire est une expérience unique dans une vie pour les passionnés.Les observatoires professionnels poursuivront également une surveillance intensive. En plus des observations des sondes JUICE et Psyche en novembre, les observatoires terrestres suivront l’évolution de la comète après son passage au périhélie. Les scientifiques veulent voir comment son activité évolue à mesure qu’elle s’éloigne : va-t-elle s’estomper rapidement, ou connaître des sursauts ou une fragmentation ? Certains vérifient déjà la présence de rotation ou de variations périodiques dans sa chevelure qui pourraient indiquer un noyau en rotation ou des jets. Hubble et JWST pourraient effectuer des mesures de suivi pour affiner l’analyse de la composition (par exemple, mesurer les rapports isotopiques de l’oxygène ou de l’hydrogène dans l’eau, ce qui pourrait donner des indices sur le type d’étoile ou d’environnement protoplanétaire d’où elle provient). Même après que 3I/ATLAS soit devenue trop faible pour être observée, les chercheurs exploiteront la mine de données collectées. La réunion de la Royal Astronomical Society cette année a déjà présenté des premiers résultats, et d’autres études seront certainement publiées dans des revues en 2026.
De manière cruciale, la visite de 3I/ATLAS affine les plans pour de futures missions vers des objets interstellaires. La NASA et l’ESA étudient toutes deux des concepts pour intercepter ou rejoindre ces visiteurs rares. L’ESA a une mission en préparation appelée Comet Interceptor (lancement prévu en 2029)esa.int. L’idée est de stationner une sonde dans l’espace, en attendant qu’un objet comme 3I/ATLAS soit découvert, puis de la dévier rapidement pour le rencontrer. Lorsque Comet Interceptor a été conçu, seul ‘Oumuamua était connu ; maintenant que deux autres objets très différents ont été observés, l’importance de la mission est encore plus évidenteesa.int. « En visiter un pourrait permettre une avancée décisive dans la compréhension de leur nature », déclare le Dr Michael Küppers, scientifique du projet Comet Interceptor à l’ESAesa.int. Le défi est que ces objets sont rapides et souvent détectés à la dernière minute. Bien qu’il soit improbable que nous puissions poursuivre 3I/ATLAS (il n’a été découvert que quelques mois avant son périhélie), une mission comme Comet Interceptor vise à être prête et à attendre dans l’espace le prochain visiteuresa.intesa.int. Elle servira de pionnière pour apprendre à réagir rapidement à de tels invités mystérieux.
Quoi qu’il en soit, 3I/ATLAS a déjà marqué l’histoire. C’est la comète interstellaire la plus étudiée à ce jour, et elle offre aux scientifiques et au public un spectacle cosmique de découvertes. À mesure que les données affluent, nous apprenons non seulement sur une comète, mais aussi sur le contexte plus large de la formation des comètes et des planètes dans des systèmes stellaires lointains. L’âge ancien et la composition exotique de la comète suggèrent une étoile d’origine très différente de notre Soleil – peut-être une étoile morte depuis longtemps, datant des débuts de la galaxie. Cela souligne que les éléments constitutifs des planètes (eau, composés carbonés, métaux) sont véritablement universels, disséminés à travers le cosmoswired.com. Et c’est un rappel que l’espace interstellaire n’est pas vide ; il transporte du bois flotté venu d’autres rivages, s’échouant parfois sur la plage de notre système solaire.
En résumé : La comète 3I/ATLAS est un messager interstellaire remarquable. Elle fonce actuellement près de notre Soleil, âgée de milliards d’années, se déplaçant à une vitesse record et regorgeant d’indices sur son origine étrangère. Des scientifiques du monde entier s’empressent de l’observer avec tous les outils à leur disposition. Pendant ce temps, son comportement étrange a stimulé l’imagination, allant même jusqu’à susciter des discussions sur une technologie extraterrestre – une spéculation que la plupart des experts écartent poliment, tout en reconnaissant les bizarreries de la comète. Fin octobre 2025, alors que 3I/ATLAS effectue une fronde autour du Soleil, nous sommes à l’avant-garde de la découverte. Que cet objet soit une relique cosmique d’une étoile disparue depuis longtemps ou (bien moins probable) quelque chose de plus artificiel, une chose est certaine : il a élargi notre compréhension de l’univers au-delà de notre système solaire. Alors que nous lui disons adieu dans les semaines et mois à venir, 3I/ATLAS nous laisse de nouvelles énigmes à méditer et un sentiment d’émerveillement face à la vaste galaxie interconnectée que nous habitons.
Sources : Interstellar comet 3I/ATLAS briefing – ESAesa.intesa.int ; communiqué de presse RAS NAM2025ras.ac.ukras.ac.uk ; rapports NASA & Space.comlivemint.comlivemint.com ; Sky & Telescope (Bob King)skyandtelescope.orgskyandtelescope.org ; Wired (Simone Valesini)wired.comwired.com ; NDTV Newsndtv.comndtv.com ; analyse TS2 Space Techts2.techts2.tech ; et commentaires d’experts (D. Bodewits, Z. Xing)wired.comwired.com.